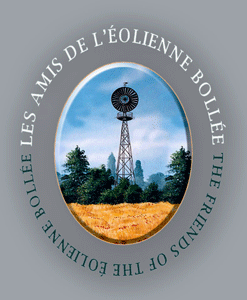
La
famille Bollée
On retrouve la trace de la famille au seizième siècle, à
Breuvannes, une ville de Lorraine où les maîtres-saintiers (fondeurs
de cloches) itinérants se retrouvaient traditionnellement pour passer
l'hiver après une saison consacrée à la coulée
et la réparation des cloches. A l'image de Jean-Baptiste-Amédée
Bollée (1812-1912) et Ernest-Sylvain Bollée (1814-91), qui avaient
choisi chacun d'épouser la vocation de leur grand-père. Jean-Baptiste-Amédée
passa l'hiver 1838-39 dans le village de Oucques (Loiret) , puis déménagea
à Saint-Jean-de-Braye, un village de la banlieue d'Orléans.
Quant à Ernest-Sylvain Bollée, il s'installa provisoirement
à La Flèche en 1839, avec le projet de partir à Angers,
mais les inondations du Loir l'obligèrent à déménager
à Sainte-Croix, à environ trois kilomètres du centre
du Mans. Bollée construisit ensuite un petit four, rue Sainte-Hélène,
qui fut allumé pour la première fois en novembre 1842.
La fabrication de cloches continua à Saint-Jean-de-Braye, où
Jean-Baptiste-Amédée fut remplacé par son fils Georges
(1849-1930), son petit-fils Louis (1878-1954), son arrière petit-fils
Jean (1908-80?), et le propriétaire actuel, son arrière arrière
petit-fils Dominique. La fonderie continua également au Mans, mais
Ernest-Sylvain avait d'autres ambitions que les seules cloches. Il acquit
un brevet d'invention pour un bélier hydraulique en 1857, et, en complément
de l'éolienne protégée par un brevet Français
N° 79985 du 30 Mars 1868, conçut des locomotives à vapeur
et même un détecteur de retour pour les pigeons voyageurs.
Ernest-Sylvain tomba gravement malade dans les années 1860, et fut
obligé de déléguer progressivement la marche de ses affaires
à ses trois fils. Le plus âgé, Amédée-Ernest
(1844-1917), se chargea de la fonderie de cloches, Ernest-Jules (1846-1922?)
s'occupa des béliers hydrauliques dans de nouveaux locaux sis rue des
vignes ; et le plus jeune des fils, Auguste-Sylvain Bollée (1847-1906),
prit le contrôle de la fabrique d'éoliennes. La fonderie de cloches
du Mans continua sa production avec succès, quoique éclipsée
petit à petit par les exploits des oncles et cousins travaillant à
Saint-Jean-de-Braye.

Ci-dessus:
un produit actuel typique de la fonderie de cloches de Saint-Jean-de-Braye,
qui est toujours fière de son savoir faire dans ce domaine hautement
spécialisé. Cliché pris par John Walter en Avril 2001.
On ne sait pas avec exactitude combien de béliers hydrauliques de type
Bollée furent construits, ni si la famille disposa du monopole des
installations dans la région Sarthoise. Néanmoins, la production
fut sans aucun doute substantielle : une commande passée en Janvier
1894 par M. Léon Boudet, propriétaire des Domaines de "
Beausen, Villaine et Chantermerle à Pruillé-le-Chétif
" fut honorée avec un " petit " bélier hydraulique
portant le numéro 0594. Ernest-Jules Bollée affirmait avoir
fabriqué 1800 béliers au début de la Première
Guerre Mondiale, à l'été 1914.

Ci-dessus: La voiture à vapeur " La Mancelle
" construite par Amédée-Ernest Bollée en 1878. Ce
véhicule est conservé dans la collection du Musée de
l'Automobile de la Sarthe.
Auguste-Sylvain - souffrant peut-être de problèmes de santé
- et se désintéressant peu à peu des Éolienne
Bollée, vendit son affaire en 1898 à Édouard-Émile
Lebert, et se retira à Paris pour se consacrer à la peinture.
Malheureusement, on sait peu de choses sur les dix dernières années
de sa vie. Sa production d'Éoliennes, qui atteignait le nombre de 219
en février 1894, est estimée à un total d'environ 260
machines.
Né le 10 Janvier 1844 à Sainte-Croix, dans les faubourgs du
Mans, Amédée-Ernest Bollée (connu après 1867 comme
" Amédée père " pour le distinguer de son fils
du même nom) avait un esprit particulièrement inventif, il est
à l'origine d'une série de véhicules à vapeur
comprenant L'Obéissante (1872-73), La Mancelle (1878), La Rapide et
La Marie-Anne. Il s'éteignit le 19 Janvier 1917 dans sa maison du Mans.
Amédée-Ernest-Marie, connu comme " Amédée
Bollée fils " pour le distinguer de son père, naquit au
Mans le 30 Janvier 1867. Il y fut rejoint le 2 Avril 1870 par son frère
Léon-Auguste-Antoine (" Léon Bollée ") et par
la suite par un autre de ses frères, Camille (décédé
en 1940). Camille devint un talentueux photographe amateur, mais Amédée
fils et Léon héritèrent de leur père l'enthousiasme
pour les voitures. En abandonnant toutefois l'un et l'autre la vapeur au profit
du moteur à combustion interne.

Ci-dessus: un exemplaire de la machine à
calculer de Léon Bollée brevetée en 1889, de la collection
du Musée des Arts et Métiers, Paris. Cliché pris par
J. Kenneth Major, Avril 2002.
Léon Bollée déposa le brevet d'une machine à calculer
mécanique en 1889, obtenant une médaille d'or à l'exposition
universelle qui se tenait cette année là à Paris, mais
se tourna bientôt vers les véhicules (comme la voiturette à
trois roues dans les années 1890) puis fut fasciné par l'aviation.
Le premier vol des frères Wright en Europe eut lieu en Août 1908,
à la demande de Léon, mais celui-ci fut sérieusement
blessé dans un accident d'avion en 1911. Epuisé par les séquelles
de ses blessures, usé par le travail, il décéda à
Neuilly-sur-Seine le 19 Décembre 1913, âgé seulement de
43 ans.
Il ne laissa pas de descendants directs, mais une trace indélébile
dans la cité de sa naissance. Léon Bollée fut un fervent
promoteur du sport automobile, notamment le précurseur de la course
des 24 heures du Mans, et fut le Président fondateur de l'Union Auto-Cycliste
de la Sarthe en plus de celui de l'Aéro-Club de la Sarthe. Afin de
résister à la crise économique qui suivit la Première
Guerre Mondiale, sa fabrique d'automobiles tenta une association avec Morris
Motors Ltd (1924-31) mais finit par fermer en 1933.

Ci-dessus: Une publicité présentée
par un distributeur Parisien de la Voiturette Bollée. Cette machine
fut baptisée " Le tue belle-mère " en raison de la
position exposée du passager ! Cliché pris par J. Kenneth
Major, Avril 2002.
Amédée Bollée fils créa la voiture le Torpilleur
en 1896, mais son activité s'était concentrée sur la
fabrication de gros véhicules de qualité à l'opposé
des voiturettes bon marché ; la production annuelle était en
moyenne de seulement trente véhicules, à comparer avec les chiffres
de l'usine de Léon Bollée : cinq cent châssis pour la
seule année 1908 ! Le plus grand succès de sa carrière
fut celui de l'usine de fabrication de segments de piston, dont l'originalité
reposait un dessin particulier de ce segment, breveté en 1912. Il s'éteignit
le 14 Décembre 1926 au Mans.
La famille Bollée n'a plus de lien direct avec l'industrie automobile,
à l'image de la fabrication des segments de piston qui fut absorbée
il y a quelques années par le conglomérat géant Renault.
Pourtant, la fonderie de cloches de Saint-Jean-de-Braye continue de fonctionner
et beaucoup des voitures (et au moins une des voitures à vapeur) sont
encore visibles dans les musées et les rallyes de véhicules
anciens.